Cette biographie, à l’articulation du récit personnel et des chantiers de recherches, est un travail de mémoire tardif sans retour aux archives.
*
Les liens en bleu renvoient aux projets plus longuement traités.
Je suis l’auteure des photos ici présentées, sauf quelques-unes au © signalé.

CINÉMA
LA TRANSE DU RÉEL

Enfant-oiseau dans un bidonville – Abidjan
« Pour Vuillard « les mots sont une convulsion des choses », alors l’écriture fictionnelle et l’écriture savante se doivent, chacune à leur manière, de capter toute l’épaisseur de la transe du réel. »
Alban Bensa à propos de La guerre des pauvres. Éric Vuillard. Actes Sud, 2019.
Par son célèbre tableau, Ceci n’est pas une pipe [1929], appelé aussi La trahison des images, Magritte pointait la malléabilité d’une représentation selon son contexte et l’intention de l’auteur. Presqu’un siècle après, dans les milieux académiques le cinéma documentaire reste la forme canonique de la « science » et de la « vérité » sur l’être humain. Doté d’une transparence présumée, il permettrait au spectateur d’être en prise directe avec l’expérience. Au contraire de la mise en scène et de la fiction perçues comme des barrières entre les faits et le spectateur.
La forme documentaire ne nous met pas en contact avec son référant parce qu’elle serait libérée de la médiation du scénario, du jeu d’un acteur et que ses outils seraient plus légers. Non à ce positivisme. Tout système de signes repose sur une plasticité intrinsèque que la bureaucratie a cristallisé en catégorie de genres entraînant de faux débats.
Bresson : « Si on filme la vraie peur d’un acteur dans une vraie tempête sur un vrai bateau, on ne croira ni à la peur, ni à la tempête, ni au bateau. »
Le « réel » est fictivement produit. Pas de geste sans mise en scène. L’intelligibilité du sens passe par les « puissances du faux » [Deleuze] pour ouvrir au monde. Trois cinéastes avec les mêmes outils, le même temps, face à la même scène, réaliseront trois films différents. Ce qui n’empêche pas de poser la fiction comme connaissance et mode d’agir sur le réel. Seules les connaissances produites par des protocoles issus de modèles mathématiques peuvent être perçues comme « pures » ou « objectives » même si cela pose des questions sur les préalables.
Proust parle de ‘vision’. « L’impression d’une scène associée à notre sensibilité fait naître une vision. » qu’il voit comme un objet tourné vers l’intérieur « dont le style émane. » Le style est la pensée en tant que pensée donnée dans une forme ; prise dans une autre forme, ce n’est plus la même pensée.

Bidonville Le Bardot – San Pedro
MOTS ET IMAGES
Les effets de vérité se trouvent toujours du côté du regard. Chacun sait combien les gestes intellectuels et créatifs sont hybrides, transversaux, et combien la pensée fait flèche de tout bois, même de brindilles ! Lorsque Epstein dit que la durée accordée à un objet peut le transformer en événement, il renvoie à un geste de mise en scène qui fait apparaître le sens juste par un petit allongement du temps.
Pourtant cette différence de genre reste encrée dans les esprits souvent pour des raisons triviales : J’aime quand même mieux savoir si les morts vont se relever ! Dans un reportage de télévision sur les massacres du Rwanda, aucun mort ne se relève mais le spectateur, lui, se lève pour passer à autre chose. Sur ce même génocide, dans une fiction comme Shooting dogs de Michael Caton Jones, les morts se relèvent mais le spectateur reste assis, pétrifié par la vision de ce que fait la barbarie à l’intimité et au corps tout entier.
Outre la question du documentaire ou de la fiction, la restitution des connaissances dans l’institution passe par les mots. Écrits ou oraux. L’image garde souvent une place illustrative à la remorque d’un discours qui brise « l’immersion dans un semblant » dont parle Schaeffer à propos du cinéma.
Que faire de la logique discursive des mots quand on filme les états intérieurs qui ouvrent à d’autres espaces-temps ? J’ai cherché cette intériorité dans mes films sur la prison parisienne, Si Bleu si calme, le harem au Niger, Contes et Décomptes, les filles de ghetto, Little Go girls en usant de « la plus belle conquête du cinéma parlant » : « le silence. » (Henri Jeanson)
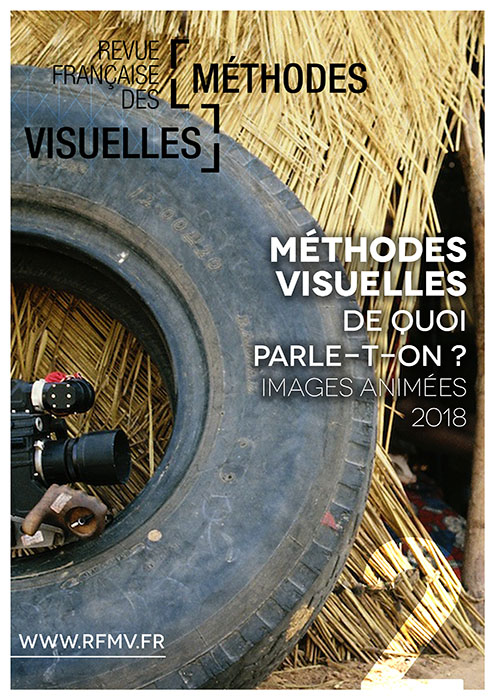
Publication
« La fausse bataille de l’art et de la science »
RÉALISME DES MOYENS

©thomaBaqueni
Dès sa genèse, le cinéma a été conçu comme un “art total”, c’est-à-dire un art qui travaille avec des blocs issus directement de notre environnement immédiat imposant un ensemble complexe de phénomènes orientables à l’infini. Un « trucage perceptif » dit Epstein.
Né dans les champs de foire, le cinéma a en gardé l’ADN dans son évolution matérielle. Il est passé : du muet au parlant puis au son spatialisé – du noir et blanc à la couleur – de l’argentique au numérique avec ses rendus « piqués ». On arrive désormais à l’image en trois dimensions. Mais il s’agit là d’un réalisme de sensations techniques. La construction d’un film « réaliste » n’a rien à voir avec le rayon bazar technique.
Au contraire, c’est par le traitement de ce « trop plein » que le geste artistique va naître : le réalisme se situe au niveau épistémologique avec des intentions déclarées. Soit par une attention aux « Nous » de Rostand : « Nous, les petits, les obscurs, les sans-grades », soit par l’usage du plan séquence [durée réelle], soit par une recherche taxidermiste de la mimèsis entre référent et représentation…
Là commence l’histoire du cinématographe, et des réalismes.
RÉALISME DE STYLE

Un film est « réel en ce sens qu’il est fidèle à l’invisible qu’on sent parfois et qui tire des choses de l’habitude, mais pas réaliste en ce sens qu’il est avant tout fidèle à des sensations et non à l’objet qui est à l’origine de celle-ci. » [Bresson]
La quête de réalisme « pur » —supposé fidèle à « l’objet » dont parle Bresson— nourrit précisément les mensonges du film de propagande. Le Kino-Pravda [Cinema-vérité] par exemple du vénéré Vertov. Dans son célèbre opus L’Homme à la caméra, il cadre magnifiquement une Union soviétique glorieuse, moderne, technique, propre, travailleuse, sportive, obéissante ; pas de clochards, pas de détritus dans les rues, pas de malades, pas de terrain vague. Le « vague » n’a pas de place dans le discours autoritaire.

Analyse comparée de deux styles
« La terre tremble » [1952] de Luchino Visconti
« Leviathan » [2013] de Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel
Document à télécharger